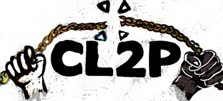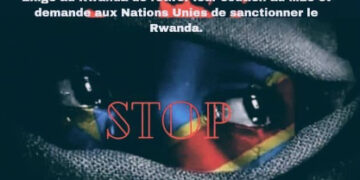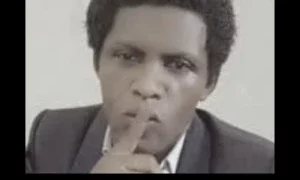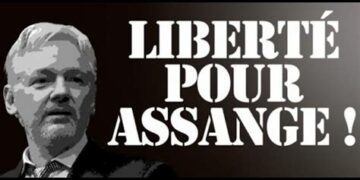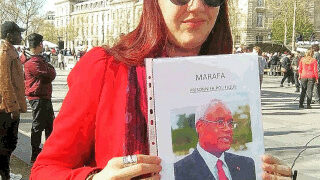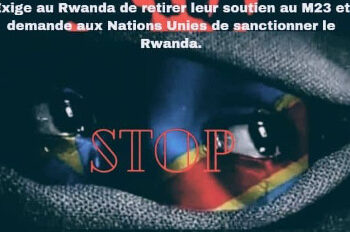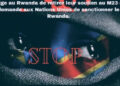Plus d’un demi-siècle après l’accession aux indépendances, les pays d’Afrique centrale sont toujours en proie aux conflits armés. À la suite du commerce des esclaves, les royaumes traditionnels de cet ensemble hétérogène ont laissé la place à des États négriers, et ce, jusqu’au XIXe siècle. Aujourd’hui, l’Afrique centrale est l’une des zones les plus instables et les plus pauvres de la planète malgré l’immensité de ses ressources minières et l’importance de son capital humain. Durant cette dernière décennie, près de onze conflits majeurs ont été recensés dans la région et tous les pays ont été concernés. Aujourd’hui, elle abrite deux des plus importantes sinon la plus importante mission de maintien de la paix des Nations unies, la Monusco. Près de 35 000 soldats de la paix, soit le quart des Casques bleus y sont mobilisés pour assurer la paix et la stabilité. Cela n’empêche pas les menaces de fuser de toutes parts en raison de plusieurs facteurs à la fois structurels et fonctionnels.
La richesse minière ne fait pas la prospérité
Vaste de plus de 6 millions de kilomètres, avec une population estimée à plus de 150 millions d’habitants en 2017, l’Afrique centrale compte parmi les régions les moins peuplées du monde. Elle bénéficie d’un climat tropical et équatorial très propice à l’élevage et à l’agriculture : 90 % des terres sont arables. Elle a une végétation des plus diversifiées au monde, un parc animalier important et rare, une hydrographie abondante, un sous-sol très riche contenant des minerais parmi les plus prisés et les plus convoités. L’Afrique centrale constitue le plus vaste réservoir des richesses mondiales de la biodiversité et des industries extractives.
Avec l’immensité de sa forêt, elle est considérée aujourd’hui comme le plus seul poumon vert de la planète à l’abri de toute activité humaine d’envergure et participe de ce fait à l’équilibre de l’écosystème mondial. D’importants gisements supplémentaires de coltan – minerai très recherché par les fabricants de smartphones –, de fer, d’uranium, de gaz et de pétrole ont été découverts ces dix dernières années, et il en reste d’autres à découvrir. Les industries extractives constituent le premier contributeur à la richesse nationale (43,8 %) et représentent 94,6 % des exportations. Les hydrocarbures participent à hauteur de 41,4 % à la richesse nationale et représentent 48 % des exportations.
Chômage et sous-emploi minent la population
Toutefois, le taux de chômage dans la sous-région reste très élevé (23,12 %), voire plus dans certains pays comme la RDC (70 %), le Tchad (30 %) ou le Congo (34 %). Là où le taux de chômage est faible, à l’instar du Cameroun (4,40 %), le sous-emploi atteint les 80 %. Malgré une croissance qui a atteint les 10 % en 2010, pour nombre de ses pays, l’indice de développement humain (IDH) est demeuré très faible – 0,13 en moyenne pour les pays d’Afrique centrale – du fait de l’espérance de vie, du niveau d’éducation et du niveau de vie relativement bas. Le chômage, le difficile accès à l’emploi et les emplois précaires minent la population. 80 % à 90 % de la population s’adonnent aux activités du secteur informel qui ne représente que 3 % du PIB en moyenne. Au niveau de son capital humain, la sous-région dispose d’une importante intelligentsia et d’une main-d’œuvre de mieux en mieux formée, mais qui choisit assez souvent le chemin de l’exil du fait de l’appauvrissement des populations, du déficit des infrastructures de base, des épidémies et des pandémies qui se font jour. Il faut ajouter à cela, des pratiques politiques d’un autre âge.
La longévité au pouvoir, source d’instabilité
Il faut en effet noter que l’une des singularités de l’Afrique centrale, c’est le temps que passent certains de ses chefs d’État au pouvoir. Cela fait partie des éléments qui concourent à engendrer nombre de conflits. Presque tous utilisent les procédés démocratiques pour se maintenir au pouvoir, renfonçant de ce fait le climat d’incertitude et d’insécurité, et ce, dans un environnement où les mécanismes de gestion de l’État n’ont pas bougé depuis des lustres. De nos jours, sont encore en fonction des dirigeants dont l’expérience date des années 1960, c’est dire le gap qui existe entre les réformes réelles et celles attendues par les populations, et ce, même après une partie de la jeunesse ait été introduit dans les rouages.
Notons que quatre chefs d’État, sur la douzaine que compte l’Afrique centrale, cumulent près d’un siècle et demi de fonction. Ici, le symbole de l’usure du pouvoir sans fin plombe toute tentative d’introduction de modernité et de progrès. Comment ces leaders qui disent incarner le changement peuvent-ils se maintenir au pouvoir si ce n’est à travers une approche désincarnée de la pensée du Madiba Mandela pour qui pour changer les choses, il faut d’abord se changer soi-même. Ce changement réel, l’Afrique centrale en a besoin en s’appuyant sur les vertus de l’alternance du pouvoir, un vaste chantier toujours inachevé. Demeurant l’un des derniers bastions des régimes autoritaires dans le monde, l’Afrique centrale secrète les poisons qui font monter mouvements indépendantistes et bandes armées de toutes sortes. Plus que jamais, l’urgence est donc de défossiliser la classe dirigeante en place dans la sous-région.
L’avenir est dans la mise en place de moyens démocratiques de transmission du pouvoir
Des soulèvements populaires de plus en plus violents ne sont pas à exclure dès lors que le changement devient une nécessité irréversible dans la tête des populations. La perspective « d’un autre printemps » contre les régimes autoritaires n’est plus à exclure malgré les manœuvres populistes de ces derniers trouvant encore quelques échos auprès d’une frange de la nouvelle génération. Les crises électorales, les crises sociales, les mouvements séparatistes de plus en plus prépondérants, les soulèvements des populations dé-tétanisés qui ont réussi à transformer leur peur en force motrice face aux régimes totalitaires en place témoignent à suffisance d’un changement qui se veut impératif et inéluctable. Les populations en panne d’emplois, en panne de logement, en panne de soins médicaux de qualité, en panne de transport, en panne d’autonomie économique, en panne de sécurité et de sûreté, en panne de formation compétitive, en panne de perspective d’avenir et espérant l’arrivée d’une dépanneuse s’impatientent et font de plus en plus entendre leur colère. Ces « masses populaires » silencieuses à la périphérie commencent à affluer vers le centre. C’est une sous-région à rebondissements à prévoir. Au-delà de certains indicateurs (rouges ou verts), plusieurs incertitudes planent à l’horizon.
La nécessité d’un renouvellement à grande échelle
Inscrire l’Afrique centrale dans la mondialisation passe par établissement d’un nouveau système. Qui dit nouveau système dit nouveaux acteurs, nouvelles méthodes, nouvelles pratiques, nouveaux accords, nouveaux modèles socio-économiques, nouvelle coopération. Le discours dominant de la communauté internationale qui se traduit généralement par le soutien aux peuples qui aspirent à la liberté et à la dignité sonne comme un réconfort et un réarmement psychologique dans l’entendement des peuples. Un positionnement géostratégique qui semble avoir germé dans l’esprit et dans le cœur de la société civile et des oppositions qui veulent être au rendez-vous. Autrement dit, ces États qui, dans leur fonctionnement, sont contre l’ordre dynamique et renouvelant des entrepreneurs politiques seront dans l’ensemble et ce, les uns après les autres, soit complètement désorganisés et démantelés, soit réduits à leur plus simple expression. Tout comme un ouragan qui fait son chemin, l’idée d’une rotation des hommes et du renouvellement des systèmes fait son chemin et, à terme, personne ne pourra s’y opposer.
* Praticien chercheur au sein de l’institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) dans les domaines de la géopolitique, la géostratégie et la sociologie.
** Chercheur à l’École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC) de l’université de Yaoundé II dans les domaines de la géopolitique et la géostratégie.