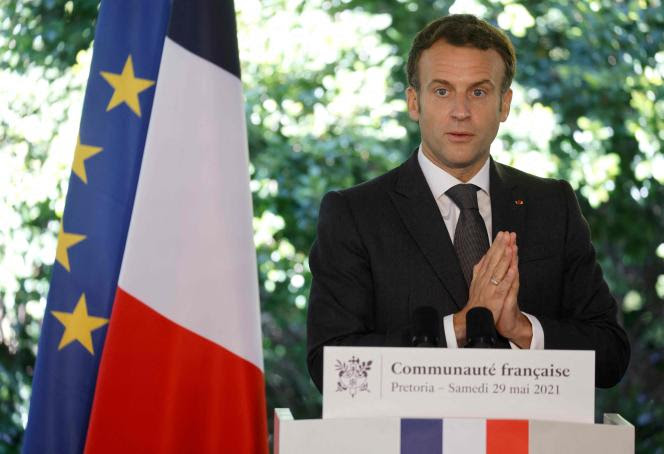« Ce n’est pas parce qu’on a rendu l’âme qu’on est vraiment mort », faisait dire Mongo Béti à l’un de ses personnages dans son roman Trop de soleil tue l’amour (éd. Julliard, 1999). La maxime pourrait s’appliquer à celui dont l’œuvre rayonne toujours, vingt ans après sa mort, et auquel la ville de Rouen rend un hommage artistique, dans le cadre de la Saison Africa2020, à travers une série d’expositions et d’ateliers. L’occasion de revisiter l’itinéraire de ce penseur et écrivain camerounais qui vécut en exil en France durant une trentaine d’années.
Né Alexandre Biyidi Awala, en 1932, dans un village du Cameroun, au sein d’une famille de planteurs de cacaos, il a 21 ans lorsqu’il arrive en France, baccalauréat en poche et doté d’une bourse. Le paradoxe d’appartenir à un pays qui ne s’appartient pas le travaille. Nous sommes en 1953, l’Afrique entière rue sous le joug colonial. Comme la plupart des jeunes intellectuels africains d’alors, il fait ses études de lettres classiques tout en militant pour l’indépendance, dans des organisations de gauche françaises.
Parallèlement, il commence à rédiger ses premiers textes lors de séjours de vacances organisés par la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (Feanf). Ses camarades se gaussent : comment peut-on prétendre écrire quand ceux qu’on appelle écrivains sont des génies occidentaux des siècles passés tels Balzac, Hugo, Châteaubriand ? L’horizon paraît inatteignable.
Dénoncer l’iniquité, le mépris, la domination
Mais le jeune homme a du cran. Publié en 1954, Ville cruelle (éd. Présence africaine), son premier roman écrit sous le pseudo d’Eza Boto, marque d’emblée par son réalisme. Ici point de paradis perdu ou de mise en scène d’un continent au passé mythifié. Les héros doivent faire face à l’injustice et à la brutalité de la situation coloniale dans une ville « cruelle et dure avec ses gradés blancs, ses gardes régionaux, ses gardes territoriaux et leurs baïonnettes au canon, ses sens uniques et ses “Entrées interdites aux indigènes” ».
Son deuxième roman, Le Pauvre Christ de Bomba (éd. Présence africaine, 1956), signé Mongo Béti, s’en prend à l’évangélisation missionnaire. Le regard critique de l’auteur n’est pas dénué d’humour. Son personnage du père supérieur est persuadé que Dieu pardonnera aux Africains, « à la condition qu’ils renoncent à leurs erreurs passées et qu’ils prennent la bonne résolution de devenir des bons chrétiens ».
A 25 ans et déjà deux livres à son actif, Mongo Béti affirme avec vigueur ce qui va donner sens et dignité à sa vie : écrire pour dénoncer sans relâche l’iniquité, le mépris et toutes les formes de domination. « La fonction de l’écrivain n’est pas de donner bonne conscience [à la société], mais de lui fournir cette mauvaise conscience dont elle a besoin pour s’améliorer chaque jour davantage », expliquera-t-il.
C’est pourquoi, avec lui, tout le monde en prend pour son grade. Si deux autres romans, Mission terminée (éd. Buchet Chastel, 1957) et Le Roi miraculé (éd. Buchet Chastel, 1958) dénoncent, comme les premiers, le système colonial, il pourfend tout aussi bien par la suite les avatars démocratiques de l’Afrique post-indépendance, qui anéantissent les espoirs d’une nouvelle ère politique.
Répression de la France et de son affidé Ahidjo
Mongo Béti alignera ainsi, au fil des ans, une dizaine d’ouvrages décapants et subtils, salués par un lectorat grandissant, mais accueillis avec plus de méfiance par les autorités camerounaises et françaises. Il paiera très cher le prix de son engagement. Dans les années 1960, l’Etat camerounais lui retire sa bourse pour le contraindre à rentrer au pays. Il choisit l’exil, entre à l’Education nationale française, passe l’agrégation, se fixe à Rouen en 1965, où il enseigne, au lycée Corneille, le français, le latin et le grec. Il interrompt pour un temps l’écriture de livres, mais le sort de son pays d’origine ne le laisse pas en paix.
Quittant le roman pour l’essai, il publie en 1972 Main basse sur le Cameroun. Autopsie d’une décolonisation (éd. François Maspero), qui jette un éclairage sans concession sur la répression exercée par la France et son affidé, le président Ahmadou Ahidjo, durant la guerre de libération au Cameroun (1956-1975). Un dossier dramatique et obscur soigneusement effacé du récit national des pays concernés. Le livre est interdit en France.
Qu’à cela ne tienne, l’image de Mongo Béti en sort encore grandie. Il crée en 1978 Peuples noirs, Peuples africains, bimestriel politique et indépendant qui paraîtra jusqu’en avril 1991. Revenu à la fiction, il est invité par Bernard Pivot pour présenter son livre Les Deux Mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, futur camionneur (éd. Buchet-Chastel, 1983) à la télévision. L’animateur aimerait évoquer la cocasserie du livre, mais Mongo Béti profite de la tribune qui lui est offerte pour dénoncer les régimes africains et la complicité silencieuse des autorités françaises. « Je fais partie des non-conformes », précise-t-il.
Librairie des peuples noirs
Au fil des ans, la stature de Mongo Béti s’est renforcée. Il est traduit dans plusieurs langues, étudié à l’international et est même inscrit dans les programmes de son pays natal… mais uniquement pour ses œuvres anticoloniales. « Il m’est arrivé d’entendre des Camerounais me réciter des extraits entiers de Ville cruelle », raconte sa veuve, Odile Biyidi-Tobner.
A l’âge de la retraite, en 1994, Mongo Béti peut enfin rentrer au Cameroun sans craindre d’être inquiété. L’accueil populaire sera inversement proportionnel au mépris des autorités. Des centaines d’admirateurs l’acclament à sa descente d’avion, la presse nationale se contente d’évoquer un « touriste français en visite au Cameroun ».
Mais le visiteur a bien l’intention de s’installer. Il ouvre à Yaoundé la Librairie des peuples noirs, lui qui a toujours cru en la puissance de l’écrit pour développer l’esprit critique et éveiller les consciences. Son décès en 2001 interrompt l’écriture de son dernier roman. Ironie de l’histoire, c’est encore en France que l’on célèbre aujourd’hui la mémoire de celui qui a rendu l’âme sans être jamais vraiment mort.